Interfaces cerveau-ordinateur : quelles implications éthiques?

A la question “quelles implications éthiques ?” pour le recours, sans doute en voie d’extension à l’avenir, des interfaces directes ordinateur-cerveau humain (via implantation de puces et autres capteurs cérébraux ou connexion à des dispositifs externes), il est encore trop tôt pour y répondre complètement – mais pas trop tôt pour se la poser. Une bonne partie de la réponse dépendra évidemment, en premier lieu, de la déontologie et du respect des règles (ou réglementations?) par les concepteurs et, pour partie également, des acteurs qui les utiliseront.
Mais dès à présent, certains observateurs soulèvent des questions cruciales. Parmi eux, Laure Tabouy, chercheuse en éthique des neurosciences, des neurotechnologies, du numérique et de l’IA à l’université d’Aix-Marseille Université. Se dirige-t-on vers une “captation”, une sauvegarde et, dans la foulée, une commercialisation ou utilisation abusive des pensées, sentiments, réactions conscientes ou non… ?
Implants cérébraux, écouteurs, lunettes connectées, bandeaux… existent déjà et continuent d’être développés.
Si l’encadrement de l’utilisation des neurotechnoloigues dans le secteur médical existe bel et bien mais “reste à approfondir, en particulier en raison de ses liens avec l’intelligence artificielle (IA), il faut souligner que les utilisateurs et leurs “données cérébrales” ne sont plus juridiquement et éthiquement protégés dans le cadre d’utilisations non médicales”, écrit la chercheuse dans une tribune publiée sur le site The Conversation.
Quid dès lors de l’encadrement d’utilisations “grand public”, que ce soit à des fins (présumées ou réelles) de bien-être, de loisirs, d’éducation…?
Comment sont et seront traitées, utilisées, exploitées, interprétées les “données cérébrales” captées, sous la multitude de formes qu’elles prennent – moléculaires, cellulaires, génétiques, anatomiques, fonctionnelles, comportementales, computationnelles, neuro-électriques?
“Cette diversité de données regroupées sous le nom de “données cérébrales” n’est pas mesurable et visualisable avec les mêmes techniques, ce qui donne une diversité d’approches, de théories et de conceptions scientifiques de la pensée, qui s’entrechoquent également avec des conceptions plus philosophiques ou théologiques de la pensée, qui, elles, ne se mesurent pas.”
Comment définit le concept de “vie privée mentale”, s’interroge dès lors Laure Tabouy. Et “les données cérébrales sont-elles suffisantes pour caractériser un être humain?” Est-ce d’ailleurs acceptable, ethniquement? “Aujourd’hui, c’est à cette frontière de la conscience et des pensées que se cache une porte vers notre intimité et notre liberté, vers notre humanité la plus profonde, que ces technologies nous proposent d’ouvrir.”
Face à l’“ombre de cette menace” qui se dessine, elle recommande la définition et la mise en oeuvre d’un cadre de gouvernance mondiale, une réflexion internationale sur les enjeux éthiques des neurotechnologies.
A lire : “Neurotechnologies : nos pensées sont-elles à vendre?” – Publié dans The Conversation.


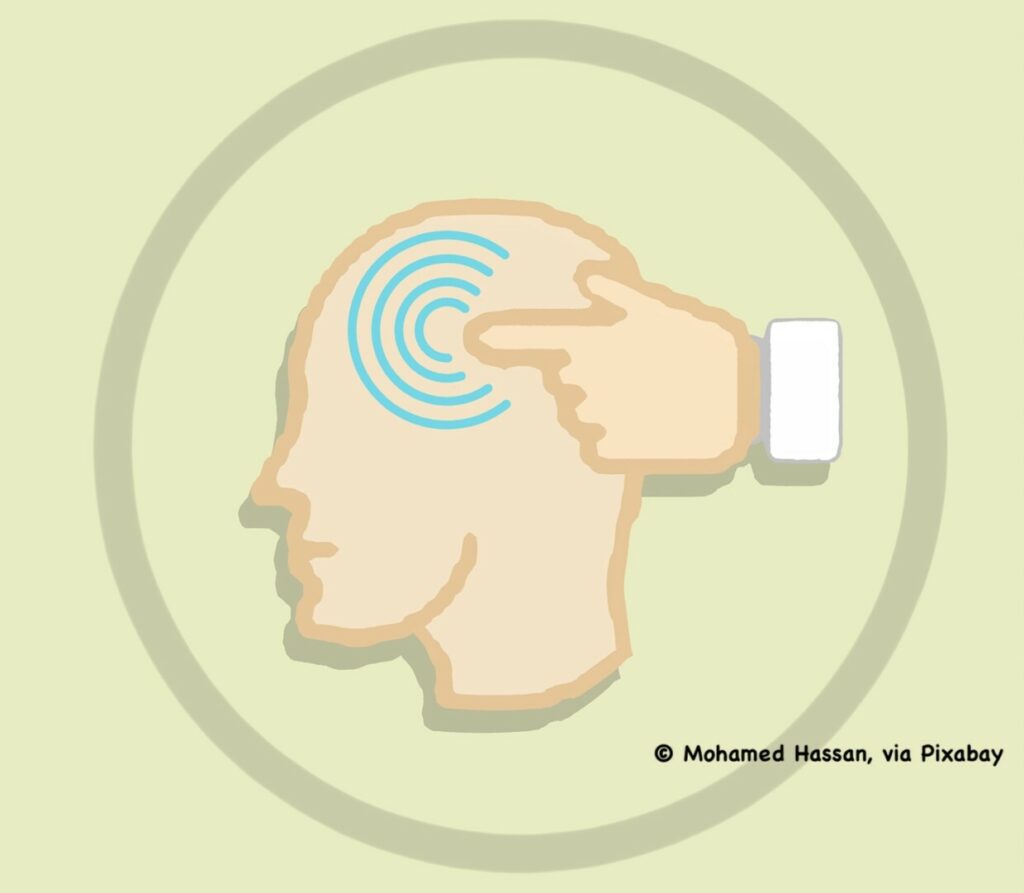


Réponses